1. PRÉSENTATION
Mali, officiellement république du Mali, pays d’Afrique de l’Ouest, enclavé entre l’Algérie au nord-est, le Niger au sud-est, le Burkina, la Côte d’Ivoire et la Guinée au sud, le Sénégal et la Mauritanie à l’ouest. Le Mali, que traverse le tropique du Cancer, couvre une superficie de 1 240 192 km². Sa capitale est Bamako.
2. LE PAYS ET SES RESSOURCES
2.1. Relief et hydrographie
 Une grande partie du Mali se situe
dans la vallée du Niger et se caractérise par des plaines basses et des bassins
sédimentaires. Au centre, le delta intérieur du Niger occupe la plaine du Macina. La
cuvette se relève sur ses bords. Au sud, des blocs anciens profondément entaillés
marquent la frontière avec la Côte d’Ivoire. Plus à l’ouest s’élève le
plateau mandingue. Les reliefs réapparaissent au centre, sur la rive droite du Niger. Les
falaises de Bandiagara dominent la plaine de 200 à 500 m. Elles sont prolongées par
les monts Hombori, culminant à 1 155 m. Au nord-est, l’adrar des Iforas se
dresse au sud du Sahara, et la dépression de Taoudenni au nord.
Une grande partie du Mali se situe
dans la vallée du Niger et se caractérise par des plaines basses et des bassins
sédimentaires. Au centre, le delta intérieur du Niger occupe la plaine du Macina. La
cuvette se relève sur ses bords. Au sud, des blocs anciens profondément entaillés
marquent la frontière avec la Côte d’Ivoire. Plus à l’ouest s’élève le
plateau mandingue. Les reliefs réapparaissent au centre, sur la rive droite du Niger. Les
falaises de Bandiagara dominent la plaine de 200 à 500 m. Elles sont prolongées par
les monts Hombori, culminant à 1 155 m. Au nord-est, l’adrar des Iforas se
dresse au sud du Sahara, et la dépression de Taoudenni au nord.
Le sud et le centre du Mali sont irrigués par deux fleuves : le Sénégal, ainsi que le Niger, né dans le Fouta-Djalon, qui forme un arc de cercle à travers le Mali, et ses affluents, le Bani et le Baoulé. Le tiers nord du pays se trouve en zone désertique, dans le bassin fermé de Taoudenni, tandis qu’à l’est, le Tilemsi, né dans l’Adrar des Iforas n'est plus qu'un affluent fossile du Niger parsemé de points d'eau.
2.2. Climat
Trois zones climatiques se succèdent du nord au sud : le Nord appartient à la zone saharienne?; le delta intérieur du Niger s’étend dans la zone sahélienne semi-aride, où s’opère la transition entre le désert et la savane arborée?; enfin, le Sud connaît un climat soudanien.
Les températures moyennes sont comprises entre 24 et 32?°C dans le Sud, et s’élèvent au fur et à mesure que l’on progresse vers le nord. Les précipitations annuelles varient d’environ 1 120 mm à Bamako à moins de 127 mm dans le Sahara.
2.3. Flore et faune
La végétation est rare dans la région saharienne où ne poussent que des acacias et des gommiers. La zone sahélienne du centre est caractérisée par une savane arbustive, au sein de laquelle dominent les épineux. Elle laisse la place à la savane arborée dans le Sud soudanien, où les cours d’eau sont encadrés par des forêts-galeries. La faune malienne compte des animaux tels le guépard, l’oryx, la gazelle, le phacochère, le lion, le léopard, l’antilope et le chacal.
3. POPULATION ET SOCIÉTÉ
3.1. Démographie
 En 1987,
7 620 225 habitants avaient été recensés. En 1998, la population
malienne était estimée à 10 108 569, soit une densité moyenne de
8,2 habitants au km2.
Les neuf dixièmes des Maliens habitent le Sud. Sur la période 1990-1995, le taux de
croissance de la population était de 3,2 % par an. La mortalité infantile demeurait
élevée (122 p. 1 000), de même que l’indice de fécondité (7,02).
L’espérance de vie à la naissance était de 47 ans.
En 1987,
7 620 225 habitants avaient été recensés. En 1998, la population
malienne était estimée à 10 108 569, soit une densité moyenne de
8,2 habitants au km2.
Les neuf dixièmes des Maliens habitent le Sud. Sur la période 1990-1995, le taux de
croissance de la population était de 3,2 % par an. La mortalité infantile demeurait
élevée (122 p. 1 000), de même que l’indice de fécondité (7,02).
L’espérance de vie à la naissance était de 47 ans.
40 % des Maliens sont des Mandingues, majoritairement des Bambara. Ils vivent principalement dans l’Ouest (Bamako). Les Songhaï sont établis dans l’Est, les Soninké dans l’Ouest (Kayes)?; les Sénoufos vivent autour de Sikasso, dans la zone frontalière avec le Burkina et la Côte d’Ivoire. Plus au nord-est vivent les Dogon, sur le plateau de Bandiagara. Les Peul peuplent la cuvette du Macina tandis que le Sahara est le domaine des Maures et surtout des Touareg qui nomadisent entre l’adrar et la boucle du Niger. Ces derniers, au nombre d’environ 400 000, ont toujours refusé la domination politique des Mandingues depuis l’indépendance, laquelle a également signifié pour eux la fixation des frontières et l’intégration à un cadre étatique dont ils s’accommodent mal. Un pacte national fut conclu, en avril 1992, entre le gouvernement malien et les Touareg, dont la rébellion armée s’était intensifiée dans le nord, comme au Niger voisin. Si le conflit s’est apaisé, le problème de la définition d’un espace autonome pour les Touareg demeure.
3.2. Découpage administratif et villes principales
 Le Mali est divisé en huit
régions administratives, auxquelles s’ajoute le district de la capitale, Bamako. Les
plus grandes villes ont des maires et des conseils municipaux élus. Les villes
principales sont Bamako, la capitale, Ségou et Mopti, importants centres de pêche
situés sur le cours inférieur du Niger. En 1997, 28% des Maliens étaient citadins.
Le Mali est divisé en huit
régions administratives, auxquelles s’ajoute le district de la capitale, Bamako. Les
plus grandes villes ont des maires et des conseils municipaux élus. Les villes
principales sont Bamako, la capitale, Ségou et Mopti, importants centres de pêche
situés sur le cours inférieur du Niger. En 1997, 28% des Maliens étaient citadins.
3.3. Langues et religions
 La langue officielle est le
français. Les langues mandé — bambara, malinké et dyula — ainsi que
les langues voltaïques — dogon, sénoufo —, le songhaï, le hassanya
et le tamacheq demeurent vivantes au sein des différentes communautés (voir
langues d’Afrique). Le bambara tend à devenir la langue véhiculaire nationale.
La langue officielle est le
français. Les langues mandé — bambara, malinké et dyula — ainsi que
les langues voltaïques — dogon, sénoufo —, le songhaï, le hassanya
et le tamacheq demeurent vivantes au sein des différentes communautés (voir
langues d’Afrique). Le bambara tend à devenir la langue véhiculaire nationale.
 L’islam, teinté
d’animisme, est la religion de 90 % de la population. Quelque 9 % des
Maliens ont conservé des croyances animistes. Le christianisme concerne 1 % de la
population.
L’islam, teinté
d’animisme, est la religion de 90 % de la population. Quelque 9 % des
Maliens ont conservé des croyances animistes. Le christianisme concerne 1 % de la
population.
3.4. Éducation
Le taux d’alphabétisation était de 31 en 1995. Moins du quart des enfants maliens en âge scolaire vont à l’école. Le taux de scolarisation était de 37,3 % dans le primaire, de 10,8 % dans le secondaire, et de seulement 0,8 % au niveau universitaire en 1996. Bamako possède des écoles de gestion, de médecine et d’ingénieurs.
3.5. Institutions et vie politique
De 1968 à 1991, le Mali est dirigé par Moussa Traoré, porté au pouvoir par un coup d’État militaire. Élu deux fois sans opposition, le président Moussa Traoré gouverne en dictateur, s’appuyant sur le seul parti politique légal, l’Union démocratique du peuple malien (UDPM), fondé en 1979.
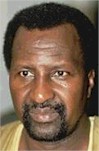 Après son renversement, en mars
1991, un régime démocratique est établi et les premières élections libres sont
organisées un an plus tard.
Après son renversement, en mars
1991, un régime démocratique est établi et les premières élections libres sont
organisées un an plus tard.
L’Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA) remporte la majorité des 129 sièges à l’Assemblée nationale?; son candidat, Alpha Oumar Konaré, est élu président de la République en 1992 et réélu en 1997.
4. ÉCONOMIE
 En 1997, le produit national brut
global (PNB) était de 3 milliards de dollars, soit un PNB par habitant de 260 dollars. Le
Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. Il n’a cessé de
s’appauvrir de 1985 à 1993, avec une croissance annuelle négative de 1 % en
moyenne, tandis que sa dette extérieure brute était égale ou supérieure au PNB.
L’économie malienne est essentiellement agricole et les récoltes dépendent presque
totalement de l’irrigation et surtout des inondations du Niger et de ses affluents.
En 1997, le produit national brut
global (PNB) était de 3 milliards de dollars, soit un PNB par habitant de 260 dollars. Le
Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. Il n’a cessé de
s’appauvrir de 1985 à 1993, avec une croissance annuelle négative de 1 % en
moyenne, tandis que sa dette extérieure brute était égale ou supérieure au PNB.
L’économie malienne est essentiellement agricole et les récoltes dépendent presque
totalement de l’irrigation et surtout des inondations du Niger et de ses affluents.
La dévaluation du franc CFA, en janvier 1994, a favorisé l’élevage, mais la mise en place d’une politique de rigueur, si elle a permis de réduire les déficits publics, a engendré une aggravation des conditions de vie de la population. En 1993 et 1994, le pays fut secoué par des manifestations étudiantes. Des concertations régionales permirent de rouvrir les écoles et l’université et de ramener la paix sociale, nécessaire au redressement économique.
4.1. Agriculture
L’agriculture occupait, en 1995, 73 % de la population active et contribuait pour 44 % au PNB. Elle se concentre sur les terres irriguées par le fleuve Niger, par ailleurs riche en poissons.
Les principales cultures vivrières sont le millet, le riz, le sorgho et le maïs. Les arachides, le coton et la canne à sucre sont cultivés pour l’exportation. L’élevage constitue une activité très importante?; le cheptel comptait 5,72 millions de bovins, 5,95 millions d’ovins, 8,55 millions de caprins et 24 millions de volailles en 1998. Les poissons (133 000 t) du Niger assurent la nourriture des riverains du fleuve. L’industrie de la pêche produit un surplus, qui est séché et fumé pour l’exportation dans les pays voisins.
4.2. Mines et industries
Les ressources minières sont les phosphates, le sel, l’or et l’uranium. Elles n’ont pas toutes été prospectées. Le sel fait l'objet d'un commerce traditionnel et l'or est prospecté de manière artisanale. L’activité industrielle est peu développée (11 % du PNB). La seule industrie du coton, contrôlée par la Compagnie malienne de développement des textiles et très protégée, assure 40 % de la valeur ajoutée industrielle. 61,54 % de l’électricité produite sont d’origine hydraulique.
4.3. Échanges
L’unité monétaire est le franc CFA, divisible en 100 centimes et dévalué de moitié en janvier 1994. Elle est émise par la Banque centrale des États d’Afrique occidentale. Durant la présidence de Modibo Keita, son premier chef de l’État, le Mali avait quitté la zone franc et créé sa propre monnaie, le franc malien.
La plus grande partie des opérations de commerce extérieur est entre les mains de l’administration. Les principales exportations concernent le coton, le bétail, les arachides et le poisson. Le pays importe essentiellement des produit pétroliers, des véhicules automobiles, des produits alimentaires, des machines et des produits chimiques. En 1994, le taux de couverture des importations par les exportations ne dépassait pas 40 %. Les principaux partenaires commerciaux du Mali sont la France, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
Une part essentielle des transports est assurée par le fleuve Niger, navigable sur la majeure partie de son cours entre juillet et janvier. Le Sénégal est navigable de Kayes à Saint-Louis du Sénégal. Une voie ferrée relie Koulikoro, Bamako et Kayes au port de Dakar. Le Mali possède environ 15 100 km de routes, dont 8 % seulement sont goudronnées. Près de Bamako se trouve un aéroport international. Air Mali, la compagnie aérienne nationale, assure des vols intérieurs et internationaux.
5. HISTOIRE
5.1. Le Mali des grands empires
L’adrar des Iforas est riche en vestiges néolithiques, témoignant de l’époque (Ve millénaire avant notre ère) où le Sahara était une savane. Les migrations des populations sahariennes vers la vallée du Niger débutent au IIIe millénaire alors que le climat se fait plus aride. À l’aube de notre ère, le delta intérieur du fleuve est déjà au cœur des échanges entre la savane et le désert. Les premières cités s’y développent, telle Jenné-Jeno (ou Djenné-Jéno), près de l'actuelle Djenné. Le commerce transsaharien du sel et de l’or fonde la prospérité de l’empire du Ghana, érigé par les Soninké, vers le Ve siècle apr. J-.C., dans cette région du Soudan occidental, entre les fleuves Niger et Sénégal. En 1076, l’empire succombe sous les coups des Almoravides berbères, qui ont entrepris l’islamisation de l’Afrique occidentale. C’est à cette époque que les Bambara s’établissent dans la région. Au XIIIe siècle, le Ghana, redevenu un royaume est absorbé par l’empire du Mali, qui contrôle les gisements aurifères du Haut-Sénégal-Niger et qui, à son apogée, sous le règne de Kankan Moussa, étend son influence sur toute la savane de l’Ouest africain, jusqu’à l’Atlantique. Djenné, Gao et Tombouctou commencent à devenir de grands centres commerciaux, artistiques et intellectuels de l’islam soudanais. Leur rayonnement s’accroît encore après que l’empire du Mali s’est effacé, au XVe siècle, au profit du royaume de Gao. Les armées de Sonni Ali, puis d’Askia Mohammed diffusent l’islam à travers la savane et donnent à Tombouctou son rayonnement. Au maximum de son extension, le royaume de Gao, devenu l’Empire songhai, couvre la plus grande partie du Mali moderne, englobe à l’ouest des territoires de l’actuelle Guinée et étend son influence jusqu’à Kano, au nord du Nigeria. L’Empire est détruit par une expédition marocaine en 1591.
Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, le territoire malien est morcelé en plusieurs petits États, dont celui de Ségou fondé par les Bambara. Ces derniers, comme les Dogon, ont résisté à l’islamisation. Ils sont la cible de la guerre sainte menée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, par le chef musulman El-Hadj Omar, fondateur d’un empire toucouleur, s’étendant de Tombouctou jusqu’aux sources du Niger et du Sénégal — ce dernier, poursuivi par les Peul et les Bambara meurt en 1864, à Bandiagara.
5.2. La colonisation
La conquête française de la région est organisée par Joseph Gallieni, qui, à partir de 1880, mène des combats meurtriers contre les troupes de Samory Touré, chef de guerre malinké et fondateur d’un empire dans le Haut-Niger, et contre les Toucouleur, qui résistent au nord (siège de Médine contre les Français). En 1898, la conquête est achevée. Le Mali, une partie de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger actuels sont intégrés à l’Afrique-Occidentale française. En 1904, ces territoires forment la colonie du Haut-Sénégal-Niger, dont la capitale est Bamako. Elle devient, en 1920, le Soudan français après que la Haute-Volta (aujourd’hui Burkina) en eut été détachée l’année suivante.
La colonie fait l’objet d’une politique de valorisation économique, qui s’accompagne du recours au travail et à la conscription forcée. Toute activité politique est, en revanche, interdite aux colonisés jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, à Bamako, est constitué le Rassemblement démocratique africain (RDA), qui mène la lutte pour l’indépendance de l’Afrique occidentale. Sa section malienne, l’Union soudanaise, est dirigée par Modibo Keita.
En 1956, le Soudan français accède à l’autonomie interne et devient, deux ans plus tard, une république au sein de la Communauté française. Le 17 janvier 1959, il se joint au Sénégal pour former la fédération du Mali, qui se proclame indépendante le 20 juin 1960. Cette fédération éclate en septembre, en partie à cause de la rivalité entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keita, deux figures du nationalisme africain. L’ancien Soudan français conserve le nom prestigieux de Mali et Modibo Keita demeure président de la nouvelle république du Mali, proclamée le 22 septembre 1960. Le même mois, le nouvel État devient membre de l’Organisation des Nations unies (ONU).
5.3. La dictature de Moussa Traoré
Le Mali, sous la direction de Modibo Keita, qui fonde son pouvoir sur l’US-RDA, seul parti représenté à l’Assemblée, poursuit une politique de développement économique guidée par les principes du socialisme étatiste. L’échec de cette politique provoque, en novembre 1968, un coup d’État militaire qui porte au pouvoir le lieutenant Moussa Traoré. Celui-ci interdit tout groupement politique, avant de créer, en 1979, un parti unique, l’Union démocratique du peuple malien (UDPM). Le régime dictatorial de Moussa Traoré se révèle incapable de faire progresser l’économie de façon appréciable. De 1968 à 1974, puis de 1983 à 1985, des sécheresses persistantes entraînent des famines, tandis que l’État épuise ses maigres ressources dans un différend frontalier avec le Burkina. Le contentieux territorial, portant sur la bande d’Agacher, s’aggrave jusqu’à provoquer un affrontement armé entre les deux pays, en 1985. Il est réglé en 1986 par la Cour internationale de justice.
Cette même année est marquée par d’importantes grèves étudiantes et syndicales. Au mécontentement causé par la crise économique, à l’impopularité des plans d’ajustements structurels mis en œuvre à partir de 1981, s’ajoute l’aspiration démocratique, qui se traduit, en 1990, par la formation de trois mouvements politiques d’opposition. Dans le même temps, la rébellion armée des Touareg reprend avec vigueur au nord. La répression brutale par l’armée des manifestations populaires en faveur de la démocratisation aboutit au renversement de Moussa Traoré, en mars 1991.
5.4. Le retour à la démocratie
Les libertés publiques sont rétablies par un Comité transitoire pour le salut du peuple, dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumany Touré et sous l’égide duquel sont organisées les premières élections libres du Mali indépendant. En février 1993, Moussa Traoré, au terme d’un procès exemplaire, est condamné à mort et gracié en 1997. Le nouveau régime, présidé par Alpha Oumar Konaré, un professeur d'histoire qui a manifesté sa volonté de résoudre le conflit touareg, mais aussi la crise sociale, par la négociation. Ses efforts pour renforcer la démocratie demeurent cependant menacés par la persistance des difficultés économiques. En mai 1997, il est réélu avec 80 % des suffrages exprimés (l’opposition a appelé au boycott). Avec un budget plus ou moins en équilibre, et la bonne image que présente son président qui affiche un train de vie modeste, le Mali est souvent cité comme un pays de «?bonne gouvernance?». Conformément à la Constitution, le président Konaré, qui terminera son second mandat en 2002, entend ne pas s’accrocher au pouvoir.